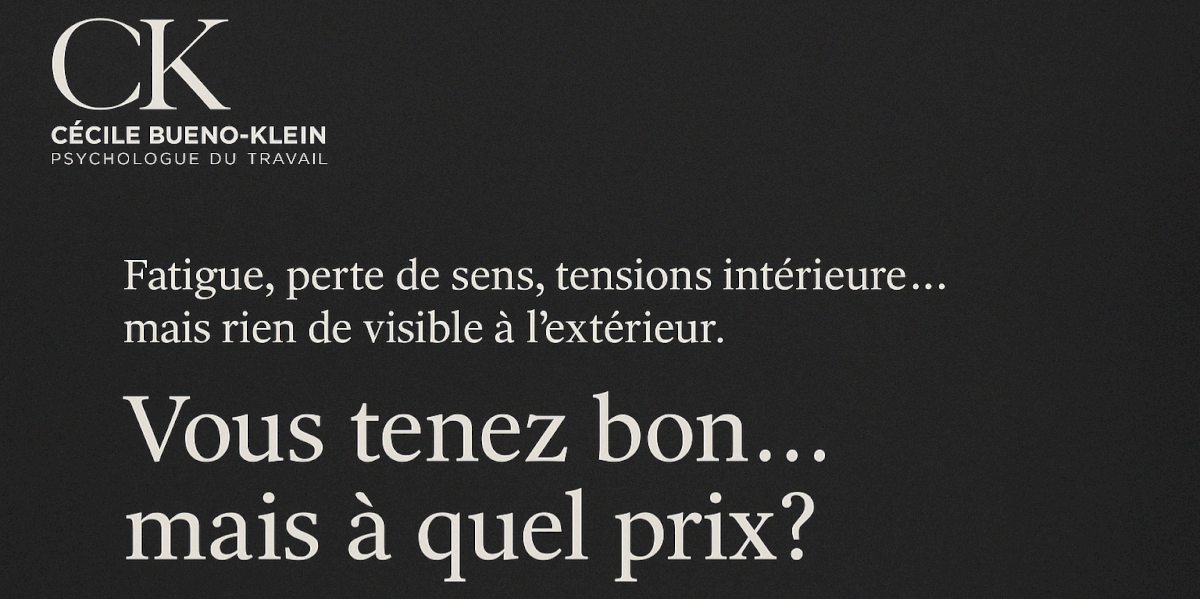
OSEZ LA VIE QUI VOUS RESSEMBLE
- Mardi 06 Mai 2025
- #DEVELOPPEMENT PERSONNEL
- Partager
La maison intérieure : une métaphore pour mieux comprendre nos exigences et notre quête d’alignement intérieur
Dès l’enfance, parfois sans en avoir conscience, nous commençons à construire une maison. Pas une maison en briques, mais une maison intérieure : notre personnalité. Et cette construction commence très tôt.
Les recherches en neurosciences affectives, ainsi que les travaux de Boris Cyrulnik sur les mille premiers jours de la vie — voire trois mille, comme il le précise parfois dans ses conférences — montrent combien cette période est décisive. C’est là que se jouent les fondations essentielles : la sécurité affective, les premières expériences de lien, la manière dont l’enfant se sent accueilli dans le monde. Si l’environnement est suffisamment stable, prévisible et empathique, alors l’enfant peut poser les premières briques d’une maison intérieure vivable. Sinon, les murs se montent trop vite ou de travers — pour se protéger, pour s’adapter, rarement pour « s’habiter ».
Nous ne partons donc pas de rien. Il y a une charpente initiale : un tempérament de base, une histoire transgénérationnelle, une qualité de l’attachement. Mais autour de cette structure, nous bâtissons. Et très tôt, nous apprenons à construire avec ce que l’on attend de nous. « Sois sage. Sois gentil. Sois performant. Sois discret. » Alors on s’applique. On développe des murs bien droits, des pièces fonctionnelles, une façade bien tenue. On devient une maison confortable pour les autres. Et cette maison fonctionne. Elle plaît. Elle attire les compliments : « Quel enfant facile. Quelle personne fiable. Quel professionnel rigoureux. » Les autres s’y sentent bien, les patrons s’y installent. On devient cette personne sur qui l’on peut toujours compter.
Mais un jour, une voix chuchote depuis la cave ou le grenier : « Et moi, dans tout ça ? Où suis-je ? » Car il existe une autre part de nous. Une part qui ne veut pas toujours être performante ou aimable. Une part qui veut simplement être. Créer, rêver, ralentir. Mais les plans sont déjà dessinés. Les murs sont montés. Difficile d’ajouter une pièce improvisée quand tout a été calibré. Ce qui nous servait de force devient parfois une prison. Alors on continue, on compense, on s’épuise. Parce que ça fonctionne. Parce qu’on a peur de décevoir. Jusqu’à ce que quelque chose craque : burn-out, anxiété, douleurs chroniques… autant de fissures dans les murs de cette maison trop bien tenue. Et plus on vit sous pression, plus on exige — de soi, mais aussi des autres. L’exigence devient la norme. La tolérance s’efface. On ne comprend plus comment les autres peuvent être si “faibles”, alors qu’on tient encore. On oublie qu’on ne tient plus vraiment.
Mais parfois, la maison ne peut même pas être réaménagée
Dans certaines structures de personnalité, la maison a été construite si rigoureusement — ou de manière si défensive — qu’il est presque impossible de la réaménager. Ce n’est pas une simple question de volonté mais une question de structure psychique. La psychopathologie vient éclairer cela.
Dans les troubles de la personnalité paranoïaque, la maison est une forteresse : chaque ouverture est suspecte.
Dans la schizophrénie, la maison peut être éclatée : des pièces sans lien, des voix dans les murs.
Dans les états-limites, c’est une maison instable, tantôt vide, tantôt envahie, tantôt en feu.
Dans ces cas, les murs ont été construits dans un objectif de survie. Les fondations n’ont pas pu se poser sereinement, comme le décrivent Cyrulnik, Bowlby ou encore Fonagy. Il n’y a pas eu, comme le disait Winnicott, un environnement suffisamment “bon” pour que le vrai soi puisse émerger. Un faux-self prend alors le relais : un soi stratégique, conforme mais souvent usant. Ainsi, parfois, la rigidité de la maison est la condition même de la survie psychique. Difficile alors de parler d’“alignement intérieur” quand l’enjeu est de tenir debout.
Pour la plupart d’entre nous, pourtant, quelque chose peut encore bouger
La bonne nouvelle, c’est que la maison intérieure n’est pas figée. Même si les fondations sont anciennes, même si les habitudes sont solides, il est possible d’ouvrir une fenêtre là où il n’y en avait pas. De déplacer une cloison. De poser un tapis dans une pièce qu’on n’osait plus habiter. Cela demande du courage. De la lucidité. Et souvent, un accompagnement.
La psychologie contemporaine parle aujourd’hui d’alignement intérieur. Pas un idéal. Pas un état permanent. Mais une cohérence vivante entre ce que l’on ressent, ce que l’on exprime, et ce que l’on vit. Carl Rogers appelait cela la congruence. Aaron Beck ou Jeffrey Young parlent de schémas inadaptés, que l’on peut identifier, comprendre, et transformer.
Réhabiter sa maison intérieure
Revisiter sa maison, ce n’est pas tout casser. C’est parfois accepter de cohabiter avec des pièces inconfortables. Mais c’est aussi réapprendre à occuper des espaces de vie : la joie, la créativité, la lenteur, le lien. Et plus on devient doux avec soi, plus on devient bienveillant avec l’autre. Parce qu’on sait ce que c’est, de porter un masque. Parce qu’on comprend la fatigue de tenir debout à force de volonté. Parce qu’on a vu que la vraie solidité ne vient pas des murs… mais de la capacité à les repenser. Comme le dit si justement Fabrice Luchini : « Pour être ouvert à l’autre, il faut d’abord se confronter à soi. »
Alors peut-être est-il temps pour vous d’entrer dans cette maison avec un peu plus de lucidité. De regarder ce qui a été hérité, ce qui a été construit… Et de choisir, en conscience, ce que vous voulez réaménager — pour y vivre, enfin, vraiment.


