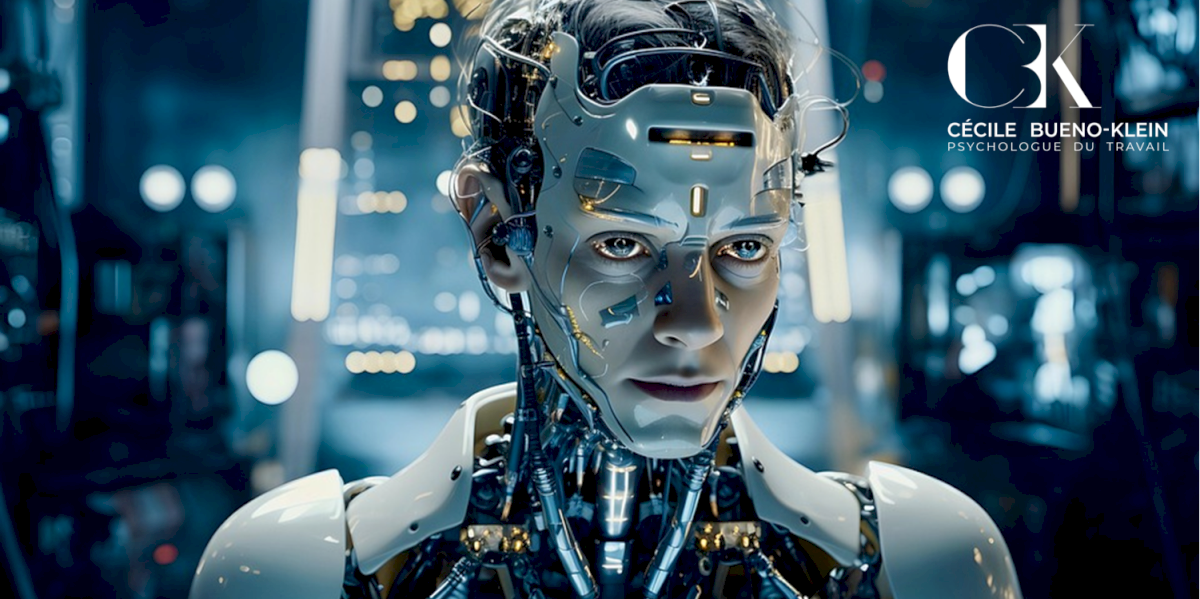
“Je vais essayer” : Pourquoi cette expression peut vous empêcher d’agir et comment y remédier
- Dimanche 23 Février 2025
- #DEVELOPPEMENT PERSONNEL
- Partager
Lorsqu’on dit « Je vais essayer », on exprime une intention mais sans engagement véritable. Bien que cette formulation paraisse innocente, elle dissimule souvent un doute, une peur de l’échec ou un manque de stratégie claire. Pour transformer une intention en action, il est essentiel de mobiliser différentes dimensions psychologiques : cognitive, émotionnelle, conative, sociale et contextuelle.
Pourquoi “Je vais essayer” freine l’action ?
Parce que la formulation « je vais essayer » suggère :
1. Un engagement flou
Dire « Je vais essayer » permet de se laisser une porte de sortie. Cette formulation, qui laisse place à l’incertitude, rend l’abandon plus facile lorsque les difficultés surgissent. En l’absence d’une décision ferme, l’action se trouve fragilisée.
2. Une absence de planification concrète
L’intention doit être accompagnée d’une planification concrète pour que l’action devienne possible. Sans une organisation structurée, le cerveau reste dans une posture d’hésitation, sans direction précise, et la tâche devient plus difficile à accomplir.
3. La présence d’émotions négatives en arrière-plan
La peur de l’échec et le manque de confiance en soi sont souvent les moteurs sous-jacents de cette expression. Lorsque nous ne maîtrisons pas nos émotions, ces peurs deviennent des obstacles puissants qui nous empêchent de passer à l’action.
4. Moins de soutien et d’encouragement
Verbaliser un « essai » plutôt qu’une action ferme peut réduire les chances de recevoir des encouragements et du soutien de la part des autres. L’engagement clair et affirmé sollicite naturellement l’aide, la reconnaissance et le soutien des proches ou collègues, renforçant ainsi la motivation.
5. Un environnement peu propice à l’action
Lorsque l’intention exprimée est faible, un contexte défavorable (distractions, manque de ressources) vient compliquer la mise en action.
Un peu de théorie : fondements scientifiques des dimensions psychologiques impliquées
Pour mieux comprendre pourquoi l’expression “je vais essayer” peut freiner l’action, il est utile d’explorer les différentes dimensions psychologiques qui influencent notre comportement. Ces dimensions, abordées par la psychologie cognitive, émotionnelle et sociale, sont éclairées par des théories scientifiques qui nous permettent de mieux saisir les mécanismes sous-jacents à nos hésitations et à notre manque d’engagement. Voyons comment la science nous aide à comprendre ces freins et à agir plus efficacement.
1. Dimension cognitive
Elle englobe les processus mentaux liés à la perception, la prise de décision et la planification. Le fait de définir un objectif précis et de structurer un plan d’action active les fonctions exécutives du cerveau, facilitant ainsi la mise en œuvre.
Référence scientifique : Les fonctions exécutives, cruciales pour la planification et la prise de décision, sont activées lors de l’élaboration de stratégies concrètes (Miller & Cohen, 2001).
2. Dimension émotionnelle
Les émotions influencent la motivation, la persévérance et la capacité à agir. Le doute, la peur de l’échec et le manque de confiance en soi entravent l’action. En revanche, un engagement affirmé peut réduire l’incertitude et favoriser un état d’esprit positif.
Référence scientifique : Les émotions sont générées par l’évaluation cognitive des situations, et leur gestion est essentielle pour la réussite (Lazarus, 1991).
3. Dimension conative
Elle concerne la volonté d’agir et la persévérance jusqu’à l’atteinte de l’objectif. Plus nous nous engageons dans une action de manière ferme, plus nous sommes susceptibles de maintenir l’effort, même face aux obstacles.
Référence scientifique : La volition, ou capacité à passer à l’action, est un moteur essentiel pour la persévérance et la réalisation des objectifs (Kuhl & Heckhausen, 1996).
4. Dimension sociale
Les interactions sociales et le soutien des autres jouent un rôle crucial dans l’engagement. Lorsqu’une personne verbalise son intention de manière positive, elle renforce la perception de sa capacité à réussir et sollicite l’encouragement des autres.
Référence scientifique : Le soutien social améliore la confiance en soi et la capacité à surmonter les difficultés (Deci & Ryan, 2000).
5. Dimension contextuelle
L’environnement et les ressources disponibles influencent également l’action. Un cadre favorable facilite la mise en œuvre des intentions, tandis que des contraintes externes peuvent entraver l’action.
Référence scientifique : Le contexte dans lequel nous évoluons joue un rôle déterminant dans la réalisation de nos objectifs (Bandura, 1997).
La motivation intrinsèque et extrinsèque
Un élément clé pour comprendre l’engagement et le passage à l’action réside dans la nature de la motivation qui sous-tend nos comportements. Selon la Théorie de l’Auto-détermination développée par Deci et Ryan, la motivation peut être de deux types : intrinsèque et extrinsèque. Chacune joue un rôle différent dans l’intention et l’action.
- Motivation intrinsèque : Elle désigne l’envie de réaliser une tâche pour la satisfaction personnelle qu’elle procure, sans attente de récompenses externes. Une personne motivée de manière intrinsèque est naturellement engagée : la transformation de l’intention en action est plus facile. Par exemple, un individu passionné par un projet n’aura pas besoin de dire « je vais essayer », il s’investira pleinement dans l’action simplement parce qu’il y trouve un plaisir ou un intérêt personnel.
- Motivation extrinsèque : Elle repose sur des facteurs externes, comme des récompenses, des pressions sociales ou des objectifs imposés. Cette forme de motivation peut rendre l’engagement moins solide et entraîner des formulations comme « je vais essayer » : l’engagement est conditionné par des attentes externes. Ainsi, les personnes motivées extrinsèquement pourraient hésiter à s’engager fermement tant que cela ne vient pas activer un de leur moteur de motivation.
Les recherches de Deci et Ryan montrent que la motivation intrinsèque est souvent plus durable et efficace à long terme. Lorsqu’une personne s’engage pour le plaisir qu’elle éprouve à réaliser l’action, cela crée un cercle vertueux de satisfaction et de performance. En revanche, lorsque la motivation est principalement extrinsèque, le risque de procrastination ou d’abandon est plus élevé.
Contributions théoriques complémentaires
Pour approfondir la compréhension des mécanismes psychologiques qui sous-tendent le passage de l’intention à l’action, il est utile d’explorer des théories qui éclairent particulièrement les processus d’engagement et de motivation. Ces théories fournissent des clés supplémentaires pour comprendre pourquoi certaines intentions restent sans suite et comment renforcer l'engagement à passer à l'action.
La théorie de l’engagement de Steven Kiesler
Kiesler a mis en lumière l’importance des actes préparatoires dans le processus d’engagement. Selon sa théorie, même de petits comportements d'engagement, comme un simple acte verbal ou un geste, peuvent renforcer l’engagement d’un individu à poursuivre une action. Cela s'explique par le besoin de cohérence entre ses actions passées et ses croyances futures. Dire « Je vais essayer » pourrait inconsciemment renforcer une tendance à l'indécision tandis qu'un engagement ferme pourrait être le premier acte qui facilite le passage à l’action (Kiesler, 1971).
L’effet de gel de Kurt Lewin
L'effet de gel, introduit par Kurt Lewin, montre que lorsqu'une personne prend une décision, même partielle ou préliminaire, cette décision tend à figer son comportement ultérieur. Lewin a démontré que des actions apparemment anodines, comme prendre une décision publique (par exemple, se prononcer sur une action à venir), rendent cette action plus probable dans le futur. Par exemple, un engagement public à « essayer » peut créer une pression sociale qui, paradoxalement, empêche l’action ferme. (Lewin, 1951).
La théorie de la réactance de Jack Brehm
La réactance est un phénomène psychologique qui survient lorsqu'une personne ressent une menace à sa liberté de choix. Selon Brehm, des formulations comme « Je vais essayer » peuvent être perçues comme une auto-limitation, augmentant l'inconfort psychologique lié à la perte de liberté d’action et incitant à la réactance. Cette dynamique pourrait freiner l’action en augmentant la tension intérieure. (Brehm, 1966).
Études de Gilchrist et Nesberg sur la motivation
Gilchrist et Nesberg ont démontré que la motivation dépend de l’état de tension interne qui découle des besoins physiologiques des individus ou de leurs aspirations psychologiques. En termes simples, plus un individu ressent une tension (qu'elle soit due à un désir non satisfait ou à un besoin de réussite) plus il est motivé à agir. Les chercheurs ont aussi souligné l'importance des désirs relationnels comme moteurs essentiels de l'action (Gilchrist & Nesberg, 1952).
“Je vais le faire” : une reformulation puissante
Au lieu de dire « Je vais essayer », optez pour « Je vais le faire ». Cette simple reformulation transforme l’intention en un engagement ferme, activant ainsi des mécanismes psychologiques puissants.
Impact du langage sur l’action et la pensée
Les recherches en psychologie cognitive et en linguistique montrent que le langage joue un rôle fondamental dans la manière dont nous percevons la réalité et prenons des décisions. Voici quelques idées clés pour comprendre cet impact :
Le langage comme reflet du "mindset"
Dire « Je vais essayer » traduit une posture de non-engagement, souvent liée à un doute ou une peur de l’échec. Prendre conscience de la manière dont nous formulons nos intentions est essentiel, car cela peut nous maintenir dans une posture d’indécision. Lorsque nous adoptons un langage plus affirmatif, comme « Je vais le faire », nous renforçons notre engagement.
Modifier le langage pour influencer la pensée
La psychologie cognitive et la linguistique démontrent que le langage structure notre pensée et notre comportement. En modifiant la manière dont nous formulons nos intentions, nous pouvons influencer notre perception de la situation et renforcer notre motivation.
Une rétroaction entre langage et pensée
Le langage n’est pas un simple reflet de nos intentions. Il influence directement notre pensée et notre capacité à passer à l’action. En prenant conscience de l’impact de notre langage, nous pouvons identifier des freins inconscients et y remédier. Modifier notre langage, même de manière volontaire au départ, peut transformer notre "mindset" et renforcer notre engagement.
Mon accompagnement : De l’intention à l’action
J’accompagne les professionnels et les particuliers en mobilisant des outils issus de la psychologie du travail, des thérapies brèves, de la sophrologie et de la méditation. Mon approche permet de lever les blocages et d’installer des stratégies durables de passage à l’action.
Mon approche en 3 étapes :
1.Identification des freins
- Analyse des croyances limitantes et des émotions bloquantes
- Evaluation du contexte et des ressources disponibles
2.Activation des leviers motivationnels
- Techniques de restructuration cognitive et de régulation émotionnelle
- Mise en place d’un plan d’action adapté
3.Accompagnement vers la mise en action
- Exercices de visualisation et de projection positive
- Prescription de tâches
- Suivi et ajustement des stratégies
Dire « Je vais essayer » peut sembler anodin mais cela conditionne inconsciemment notre engagement. Pour atteindre vos objectifs, reformulez votre intention en une décision ferme et mobilisez les bons leviers psychologiques. Adoptez une approche structurée et sollicitez un accompagnement adapté pour transformer vos intentions en réalités concrètes. Marre de votre indécision ? Envie de franchir le pas ? Contactez-moi : contact@axis-and-search.com
Besoin d’un coup de boost ? Regardez la vidéo «Allez hop, on y va ! On secoue le cocotier, on se donne un coup de pied au derrière, on agite la fourmilière, on ne réfléchit plus, en avant ! » Edouard Baer



